|
|
|
|
|
|
| ICI
(planches) |
Le groupe Marcel
Bouilloux-Lafont - Les subventions gouvernementales
(l'Aéropostale est la compagnie aérienne française
la moins subventionnée) - Le réseau
sud-américain à la fin de 1930 - Le projet africain
1928 - La reconnaissance du Sahara - Les publicités
trompeuses Latécoère en 1926 |
||||
| Février 1929 Ci-dessous les originaux | |||||
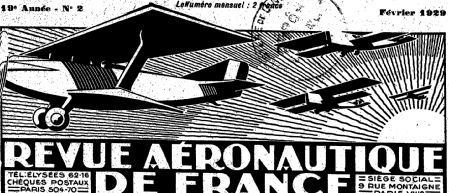 |
|||||
|
|||||
|
Les
difficultés matérielles étaient nombreuses; pourtant
elles étaient peu de chose à côté de celles d'ordre
moral qu'il s'agissait de vaincre. On imagine
facilement à quelles compétitions, à quelles
ambitions, à quelles puissances de tous ordres la
Compagnie Latécoère s'était heurtée. Peut-être se
fut-elle brisé les ailes —c'est le cas de le dire— si
un homme, imprégné de culture aéronautique naissante,
maire d'Etampes, encore ne se fut trouvé là, dont la
volonté, l'énergie, la persévérance vinrent à bout de
tout. Dans l'Amérique du Sud, M. Marcel
Bouilloux-Lafont avait de longue date déjà
groupé, sous son autorité, d'impressionnants
moyens d'action; il les mit au service de l'Aviation
française, et bientôt prenait forme, la
gigantesque entreprise destinée à maintenir et à
développer le prestige du pavillon français dans toute
l'Amérique du Sud. Les deux premières étapes du
parcours Paris-Maroc, Maroc-Dakar étant d'ores
et déjà réalisées; il s'agissait de compléter l'oeuvre
par l'organisation des troisième et, quatrième
étapes, Dakar-Brésil, Natal-Buenos-Aires. Il va
de soi, qu'avant de songer à établir la liaison
Dakar-Brésil, il fallait au préalable organiser
Natal-Buenos-Aires. C'est ce qui fut fait. Evidemment,
du cabinet où l'on suit sur une carte les étapes
envisagées, rien ne paraît plus simple que de franchir
en un clin d'oeil les plus formidables distances et le
romancier d'imagination a beau jeu à prêter à
ses héros les plus sensationnels exploits, sans qu'il
lui en coûte davantage que dé noircir deux ou trois
feuillets de papier. Sur le terrain c'est une
autre histoire. Il faut tout à la fois tenir compte,
pour l'établissement dé la ligne, des conditions
atmosphériques et climatiques des régions traversées,
de la nature du sol, des ressources en terrains
propices à l'atterrissage, des voies de communication,
c'est-à-dire s'appuyer sur une quantité de faits qui,
vus dans la pratique, non seulement ne s'allient que
rarement pour faciliter les choses, mais au contraire
s'opposent les uns aux autres, se font obstacle et
trop souvent créent le découragement, par leur
complexité hostile, chez ceux qui ont entrepris de les
amalgamer. Disons-le à la gloire de nos compatriotes,
le découragement ne vint pas, les difficultés furent
vaincues et dès le 15 novembre 1927 s'ouvrait le
service Natal-Buenos-Aires et retour. Le 1er
mars 1928, était inaugurée la liaison Dakar-Natal.
Paris-Buenos-Aires à dix jours l'une de l'autre,en attendant mieux, ce à quoi l'on travaille avec activité. Il convient, en effet, de ne pas oublier que le trajet Dakar-Natal ne se fait par hydravions que partiellement c'est-à-dire de Saint-Louis du Sénégal à Porto-Praïa (îles du Cap-Vert); le reste du parcours Porto-Praïa-Natal. est accompli par des avisos qui, pour rapides qu'ils soient, ne suppléent que de très loin, les hydravions dont les types sont actuellement à l'étude et qui, dans un avenir très prochain, permettront de réduire de moitié la durée totale du trajet. D'ailleurs la distance Paris-Buenos-Aires représente quelque treize mille kilomètres et le résultat déjà atteint représente un splendide tour de force et l'une des plus belles victoires obtenues sur las nature par l'opiniâtreté humaine. Quelques
chiffres éloquents donneront une idée des travaux,
préparatoires qu'il a fallu exécuter avant de songer à
faire l'énorme saut qui en quelques bonds
successifs, allait désormais transporter avec
régularité des hommes d'un bord à l'autre de
l'Atlantique. Laissons de côté les installations
faites sur les tronçons Toulouse-Casablanca et
Casablanca-Dakar, par la Compagnie Latécoère, et ne
parlons que des organisations des deux autres
étapes de. la ligne aujourd'hui exploitée par la
Compagnie Générale Aéropostale. Eh bien, méditez ces
chiffres! Deux tronçons ont nécessité l'établissement
de 13 aérodromes, 4, bases d'hydraviation, échelonnées
sur le parcours Saint-Louis-Buenos-Aires,16 puissants
postes de T.S.F.appareillés et, ces travaux, il a
fallu, dans bien des cas, les exécuter dans les
pires conditions qui soient, au milieu d'une
nature hostile, loin parfois de tout centre de
ravitaillement; dans des régions désertiques, on a dû
tailler, débroussailler, installer des
bâtiments, créer de toutes pièces pour ainsi dire, des
villes ou tout au moins des embryons de villes, y
apporter matériaux, matériel, carburant, vivres,
en un mot constituer des foyers de civilisation
complets et modernes là où la veille jamais peut-être
le pied d'un homme ne s'était posé.
Dans le prochain numéro de la Revue, nous reviendrons sur les détails d'organisation de la Compagnie Générale Aéropostale, sur les résultats qu'elle a obtenus, sur les buts qu'elle poursuit. Limitons-nous aujourd'hui pour terminer ce rapide exposé à rappeler les quelques grandes dates qui resteront pour témoigner des efforts constants fournis par les hommes pour se rapprocher les uns des autres et vaincre définitivement la distance. Le 16 juin 1927, le Président de la République Argentine signe un décret relatif au contrat postal argentin passé avec là Compagnie Générale Aéropostale. Le 24 août de la même année M. Doumergue sanctionne le prolongement de la ligne d'Afrique Occidentale en Amérique du Sud. Une subvention annuelle de 39 millions de francs est affectée à la nouvelle ligne. Le 15 novembre suivant, la ligne Natal-Rio de Janeiro -Montevideo-Buenos-Aires est ouverte; le 1er mars 1928 enfin, c'est la mise en exploitation, du tronçon Saint-Louis-Natal. N'est-ce pas incontestablement là une des plus,belles pages de l'histoire de l'aviation, non seulement française, mais même internationale? |
|||||
| Mars 1929, suite |
|||||
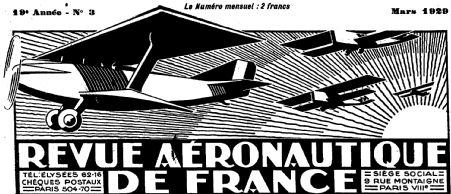 |
|||||
| La jonction Paris-Buenos-Aires est dorénavant
un fait accompli. Par la voie aérienne dix jours
suffisent pour qu'une lettre aille de Paris à
Buenos-Aires et cela avec un pourcentage de sécurité qui
atteint 100%. Par mer, la même lettre emploierait de 10
à 20 jours. Le gain est considérable, bientôt il le sera
davantage, puisqu'on compte réduire de moitié encore le
temps employé. La Compagnie générale Aéropostale n'eût-elle obtenu que ce résultat, mérite la reconnaissance de tous ceux pour qui «Le temps c'est de l'argent». Pourtant elle n'entend pas eu Tester là et elle a fait sienne la devise: «De progrès en progrès». Et elle va vite en besogne. Entre notre dernier numéro et celui-ci, la ligne Paris-Buenos-Aires a été prolongée jusqu'à la capitale du Paraguay et aujourd'hui Asuncion est reliée bi-hebdomadairement à la capitale de la République Argentine. Bientôt ce sera au tour du Chili d'être régulièrement desservi par les avions postaux. Tels sont les résultats qu'à l'heure actuelle nous pouvons considérer comme définitivement acquis, il est probable qu'au cours de l'été nous aurons à en enregistrer de nouveaux: comme par exemple, encore en Amérique, la création d'une ligue Natal-Cayenne par dessus l'immense embouchure de l'Amazone; de même encore la ligne Buenos-Aires-Rivadavia, et enfin au Chili, à Copiapo sur le Pacifique, par où passe la ligne Buenos-Aires-Valparaiso, l'établissement d'un nouveau tronçon longeant l'Océan vers le nord pour atteindre Arica aux confins du Pérou. On ne saurait trop insister sur l'importance qu'ont pour l'avenir ces créations de lignes, non seulement du point de vue commercial, mais encore du point de vue national, puisqu'elles doivent contrebalancer, en partie tout au moins, les efforts que va faire une compagnie hispano-allemande qui, en prenant Séville comme point de départ, projette de lancer par-dessus l'Océan Atlantique une ligne desservie par dirigeables. A cela s'arrête le programme envisagé actuellement par la C.G.A. pour l'Amérique. Si vaste qu'il soit, il n'est qu'une partie de celui beaucoup plus général que l'Aéropostale s'est imposé et dont l'exécution va se poursuivre en Europe et en Afrique. Bordeaux relié à Madrid, Lisbonne à Tanger, la ligne Casablanca- Dakar prolongée jusqu'au Congo Belge en suivant les côtes africaines, où elle desservira nos colonies d'Afrique occidentale, enfin une grande ligne Oran Gaô-lac Tchad-Bangui, qui circulera dans tout l'empire africain central. Telle est l'oeuvre à réaliser et cela dans un avenir prochain. On voit donc, quoi qu'on en dise, que nos compagnies françaises ne se rebutent pas à la tâche. Le plan, réalisé en son temps, mettra sous la dépendance économique de la Compagnie et l'emprise morale de notre pays, une quarantaine de mille kilomètres eu longueur. Est-il une autre Société au monde qui puisse se flatter d'un pareil effort et d'un pareil résultat. On sait que sur ces lignes diverses, la flotte aérienne de la C. G. A. se compose d'environ 250 appareils (avions et hydravions) en état de vol, surtout d'appareils terrestres Latécoère à grand rayon d'action, et munis de dispositifs permettant les vols de nuit. Les hydravions de 1.000 CV qu'elle possède actuellement relient simplement Saint-Louis du Sénégal à Praïa, l'hydrose des Iles du Cap Vert; leur rayon d'action est réduit. Mais d'autres types sont à l'étude qui seront chargés d'assurer la jonction entre les deux continents, l'Ancien et le Nouveau. Des types en chantier on attend une vitesse moyenne de 200 kilomètres minimum, avec 1.000 kilos de charge utile. Ils ne sauraient tarder à êlre réalisés. Le parcours Praïa-Natal est assuré par des avisos loués à la Compagnie générale Aéropostale par la Marine Nationale. Ces bâtiments qui jaugent de 800 à 1.000 tonnes, sont mus par des turbines à vapeur développant 6.000 CV et pouvant soutenir une vitesse de 16 à 18 noeuds. FIN |